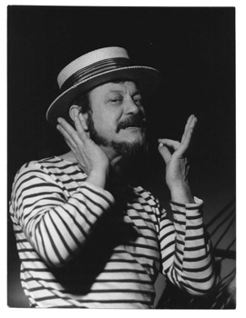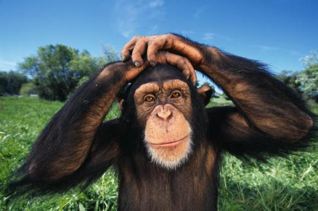L’enseignement de l’approche narrative en France est essentiellement fondé sur la maîtrise des “micro-cartes”, outils pédagogiques qui ont permis à Michael White de formaliser sa pratique afin de la transmettre.
Ces micro-cartes sont des sortes de schémas globaux de différents types de conversation narratives, qui permettent au praticien d’avoir des points de repère et de s’orienter à l’intérieur de ces conversations de façon, d’une part, à mieux comprendre ce qui s’y passe et d’autre part, à la faveur d’une métaphore “conversation = voyage”, devenir capable de forger des questions qui emmènent le client dans des endroits où il ne serait jamais allé, favorisant ainsi une description riche d’histoires alternatives.
Mais voir l’approche narrative uniquement sous cet angle risque de polariser l’attention des nouveaux praticiens sur les cartes, l’application des cartes, l’orientation dans les cartes, le respect des cartes, et de perdre de vue l’essentiel d’une conversation thérapeutique qui est de favoriser chez le client l’émergence d’une compréhension intentionnelle (se substituant aux compréhensions internes de type névrose, symptômes, caractère, traits de personnalité, etc. proposées par les traditions psychologiques classiques) et de renforcer son sentiment d’initiative personnelle.
Ce risque est encore renforcé par le fait que les cartes constituent le seul corpus constitué directement orienté vers l’apprentissage d’une pratique opérationnelle, dans les formes classiques dominantes de l’apprentissage scolaire ou universitaire. Après la mort de Michael White en avril de l’année dernière, de nouvelles cartes ont été proposées par ses successeurs australiens, plus complexes que les 5 cartes de base, comportant plus d’étages et d’étapes, spécifiques à une problématique (la carte du sentiment d’échec…) Le danger est de voir apparaître une sorte d’ingénierie pédagogique de production de micro-cartes orientées vers le traitement expert de telle problématique au lieu de se borner à être des outils de détection et d’enrichissement d’identités préférées.
Continuer la lecture de La Narrative est elle soluble
dans les micro-cartes ?