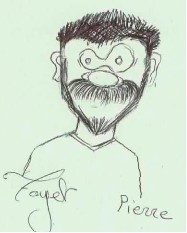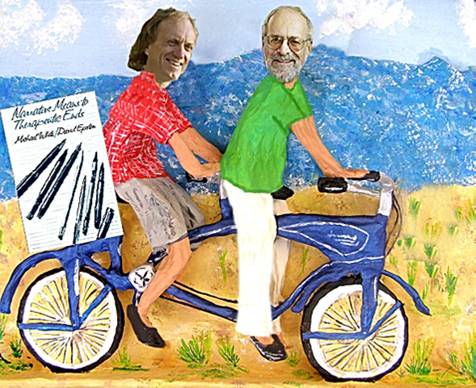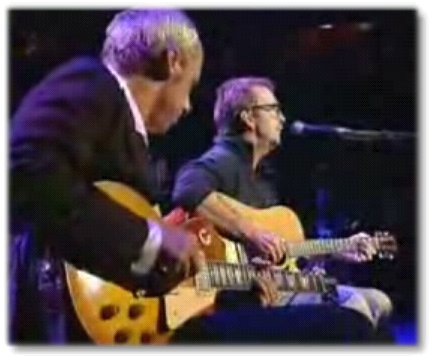Cela fait plusieurs fois que j’entends parler d’amours de jeunesse retrouvées sur des sites communautaires et dont la re-rencontre provoque une sorte d’épisode régressif de retour vers l’adolescence et de déni des choix, des engagements et des responsabilités du présent.
Il me semble que ce phénomène apparemment assez fréquent a une lecture possible en termes de définition identitaire. Nous découvrons en effet souvent la relation amoureuse à l’adolescence dans un contexte qui nous permet de construire un nouveau pan de notre identité, c’est à dire de décider en tant que personne autonome ou s’efforçant de l’être ce qui compte pour nous dans le lien amoureux et dans le choix d’un objet d’amour qui ne serait ni tout à fait papa, ni tout à fait maman.
Ceci se produit en général à un moment où nous n’avons aucune attache et où l’avenir nous apparaît entièrement ouvert, sous l’aspect métaphorique d’une surface blanche ou d’une route à dessiner, où notre style de vie laisse une large place aux topiques de l’adolescence chantés nostalgiquement par Aznavour et tous les crooners du temps disparu : “mes amis, mes amours, mes emmerdes”. Les années et les responsabilités nous isolent de ces espoirs, de ces rêves et de ces principes de notre adolescence qui constituent, comme tous les rêves et les espoirs, une part d’autant plus essentielle de notre identité qu’elle ne s’est jamais usée à l’épreuve du réel et de ses coins carrés.